
|
au sommaire de ce numéro 16 : |

| ||

Devenu reporter pour le magazine de la Marine durant 17 ans, j'ai raconté avec des mots et des clichés des missions, des plus pacifiques à d'autres plus guerrières. J'ai multiplié les embarquements, sur et au-dessus de la surface, à terre comme dans les airs, sous toutes les latitudes et ce, à différents niveaux de menace. J'ai ainsi façonné ma culture des armes, tout en prenant des cours du soir en géopolitique, histoire de mieux comprendre nos sociétés et leurs convulsions. Aujourd'hui, je garde un œil sur ces thématiques via notamment le réseau social LinkedIn. C'est là, par exemple, que j'aime à suivre la plume incisive et les propos instructifs de Nicolas Brault*. Capitaine de la Légion étrangère, ex-commando montagne et ancien prof d'histoire, cet officier français ne manque ni d'audace, ni de discernement. Si ses posts « n'engagent que [lui] », ils donnent matière à réfléchir autrement et ce, à des années-lumière des billets d'experts en management, coachs de vie ou autres reines et rois des blablas sur la toile. La guerre informationnelle est une réalité que nul ne peut désormais contester. Depuis l'investiture de Donald Trump, il ne se passe d'ailleurs pas un jour sans que ne soit prononcé une déclaration absurde, violente ou mensongère (choisissez votre qualificatif). Lui et ses obligés peuvent dérouler à l'envi une communication tous azimuts façon tapis de bombes avec en prime ses leurres. « Nous sommes dans un monde un peu orwellien, dans lequel deux et deux font cinq, si Trump le décide ! » a résumé fort à propos Olivier Berné, chercheur en astrophysique, avant d'ajouter : « les informations sont masquées, les données effacées, les vérités scientifiques disparaissent ». L'administration Trump a en effet lancé contre les chercheurs une véritable chasse aux sorcières que je combats avec mes armes, ma plume, mes images et ma vision. Comme nombre d'esprits éclairés, je m'inscris dans l'héritage des Lumières, celui d'une société fondée sur la liberté, la connaissance, l'égalité, les sciences, l'esprit critique et la fraternité. Des denrées essentielles pour nos démocraties, « le moins mauvais des systèmes » selon sir Winston Churchill. Un « lion » qui continuait de rugir en mai 1940 malgré la menace d'une guerre. Lui qui n'avait pourtant alors à offrir à ses compatriotes que « du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Lui aussi affectionne les formules choc. Je suis ses déclarations depuis de nombreux mois sur LinkedIn. « Cour de Néron […] bouffon sous kétamine […] roi du deal » : ce récent discours de Claude Malhuret** a fait mouche, et même le tour de la planète. En dénonçant avec verve ce qu'est devenu le pouvoir à Washington DC, le truculent sénateur de l'Allier semble avoir réveillé les consciences et même l'esprit de résistance. Une nouvelle preuve du pouvoir des mots qui, utilisés à bon escient, sont des armes redoutables dans le « brouillard informationnel » du moment. La promesse d'espérance également. Car comme aime à le dire l'ami Sim', pilote de l'humanitaire et co-créateur de l'ONG Aviation Sans Frontières, empruntant sa formule au président Abraham Lincoln, « honnête homme » et grand sage lui aussi : « Derrière le nuage, le soleil brille toujours ». Puissent les lumières mieux éclairer les ténèbres. Plus que jamais, ne lâchons rien et restons forts ! Stéphane Dugast
* « Quelle arme un soldat doit toujours avoir sur lui ? Un carnet et un stylo. Car une réflexion se pose sur le papier », Nicolas Brault, à suivre sur linkedin.com ** « Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis », Claude Malhuret, à suivre sur linkedin.com |
à lire en page 2 du journal Embarquements n°16 en savoir plus : instagram.com | sauvageproduction.com |
à lire en page 3 du journal Embarquements n°16 à lire également : Tara Tari : mes ailes, ma liberté, de Capucine Trochet, éditions Arthaud, 2020 en savoir plus : instagram.com | arthaud.fr |
à lire en page 4 du journal Embarquements n°16 |
à lire en page 6 du journal Embarquements n°16 en savoir plus : librairiegeosphere.com |
à lire en page 7 du journal Embarquements n°15 |
à lire en page 8 du journal Embarquements n°16 en savoir plus : antoinemerlet.com | azimutetcie.fr |

|

Willy est un passionné, il n'est pas du genre à craindre le regard des autres. Bon… vu la saison qu'il a choisie pour son itinérance, il n'a pas croisé grand monde. Mais les gens qui l'ont aperçu étaient davantage surpris que moqueurs. Ils comprenaient tout de suite que ce n'est pas un touriste en quête de sensations fortes. Moi-même, son sérieux m'a convaincu. Chaque détail de sa démarche est étayé par des travaux d'historiens. Chaque pièce de son équipement est née du savoir-faire d'un artisan médiéviste. Ça en impose ! Le piège pour moi, c'était d'omettre le contemporain. Les routes asphaltées, les antennes radio, les fils électriques… il fallait justement que je les photographie. C'est une reconstitution historique, certes, mais moi je suis journaliste ! Mon rôle n'est pas de maquiller, et le sien non plus. On est dans de l'expérimental. Je devais être là chaque matin au départ de Willy, et chaque soir avant son arrivée. Nous nous donnions simplement rendez-vous, et pour cela, l'aide de son père, Patrick, m'a été précieuse. Au volant de son camping-car, il se positionnait en base-arrière de l'expédition. J'ai donc pu faire des allers-retours pour récupérer mon propre véhicule, un van que j'ai aménagé pour y dormir. Dans le camping-car de Patrick, je pouvais également recharger mes batteries et stocker du matériel. Et vu la météo, ce n'était pas du luxe ! Finalement nous avons passé des soirées très conviviales, autour d'une cuisine à la bonne franquette. Les campagnes ne sont plus ce qu'elles étaient, et les auberges d'autrefois n'existent plus. Alors après sa journée de marche solitaire, il fallait bien qu'il se réchauffe quelque part. Il dînait donc avec nous ! Puis il allait se coucher à proximité, tantôt dans un ancien four banal, tantôt dans une église que la mairie avait bien voulu lui ouvrir. Il n'a dormi dans le camping-car qu'une seule nuit, l'avant-dernière. Ce soir-là, il avait prévu de bivouaquer autour d'un feu de camp, mais un violent orage l'a obligé à renoncer en catastrophe. Moi-même je ne faisais pas le malin ! J'ai utilisé un Canon R6 mark II avec un objectif 24-70mm. J'avais également un drone Mavic 3 Classic qui m'a permis de prendre des images plus audacieuses, notamment lors de la traversée d'une rivière à guet, ou bien au-dessus d'un éperon rocheux. En cas de coup dur, j'avais aussi un 5D mark III, un 70-200mm et un 35mm… mais je ne les ai pas sortis du sac. Enfin, j'ai utilisé des petits éclairages sur batteries afin de déboucher certaines zones. Nos choix de vie ne laissent généralement pas les gens indifférents, mais ça s'arrête là. Lui a bâti un projet pour vivre ses propres expériences. Moi je veux vivre pour informer le reste du monde. Nos démarches sont quasiment contraires. Non, parce que je suis incroyablement bon ! [Rires] Plus sérieusement, j'ai souvenir de l'Aubrac, un vaste plateau au sommet duquel il faisait grand soleil… je m'attendais à faire une très belle image. Mais de fait, c'était plat. Il ne me restait plus qu'à m'allonger dans les hautes herbes pour restituer un peu de profondeur. C'était frustrant. Il y avait aussi une équipe télé qui filmait Willy. Ils l'ont accompagné pendant deux semaines et nous nous sommes partagé les sites les plus intéressants. Moi je l'ai suivi les trois premiers jours, ensuite je devais partir à Paris pour faire une presta. Je les ai donc rejoints les trois derniers jours, avant l'arrivée à Saint-Guilhem. Et quand j'ai découvert les rushs de l'équipe vidéo, tous ces lieux que j'avais manqués, j'étais littéralement jaloux. Alors là, je passerais les deux semaines avec lui. Ça n'aurait sans doute pas été rentable, mais les lecteurs d'Embarquements devineront que je suis perfectionniste. En mars prochain, je m'en vais d'ailleurs trois semaines pour rencontrer le peuple kazakh en Mongolie. Professionnellement, c'est une erreur de partir si longtemps, mais je l'assume. Je ne dirai sûrement pas la même chose dans un an, quand je pointerai au chômage… mais pour l'heure je réalise un rêve. propos recueillis par Julien Pannetier
|

|
à lire en page 12 du journal Embarquements n°16 en savoir plus : nicolasmathys.com | aviation-sans-frontieres.org | aslav.org |
à lire en page 20 du journal Embarquements n°16 en savoir plus : paulemilevictor.fr | pointsaventure.com |
à lire en page 21 du journal Embarquements n°16 en savoir plus : societe-explorateurs.org | fondationiris.org |

|
Françoise Brenckmann : La France a une tradition d'excellence dans le domaine de l'exploration, comme en témoigne la renommée des personnalités regroupées au sein de la Société des Explorateurs Français (SEF), qu'ils soient scientifiques, écrivains-voyageurs, journalistes, aventuriers, photographes, réalisateurs… Mais ce club d'élite ne recouvre pas l'intégralité des explorateurs français. Nous avons donc souhaité ouvrir cette bourse, dédiée à la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, à des personnes peut-être un peu moins expérimentées mais qui ont du talent et qui pourraient être des aspirants membres de la SEF. Olivier Archambeau : L'idée est de faire se rencontrer le plus grand nombre de personnes autour de sujets fondamentaux pour l'avenir de notre planète. La Société des Explorateurs Français a été créée en 1937 par des explorateurs de renom. Ses 250 membres actifs sont tous des personnalités reconnues, mais en aucun cas nous avons la prétention d'être exhaustif. Il était important pour nous de permettre à des personnes extérieures, par exemple des jeunes chercheurs ou aventuriers, de candidater. Peut-être même qu'après cette expédition, ils pourront trouver leur place au sein de la SEF. Nous avons d'ailleurs créé en ce sens deux nouveaux statuts intermédiaires, d'une durée maximum de 5 ans : celui de « jeune chercheur » et celui de « compagnon » (hors recherche). C'est une sorte de pied à l'étrier pour permettre à des explorateurs, jeunes ou moins jeunes, de mettre en pratique leurs ambitions et poursuivre ensuite leur engagement au sein de la SEF, s'ils le souhaitent. FB : Le voyageur est ouvert à toutes sortes d'expériences, de rencontres, de paysages : il ne part pas forcément avec un but. L'aventurier, lui, recherche l'inédit, l'exploit, l'inattendu. Un explorateur peut être un voyageur ou un aventurier. Mais ce qui le caractérise avant tout, c'est son objectif de découverte. Qu'elle soit pour la science – une nouvelle espèce, un nouvel écosystème…, ou pour le grand public – des images inédites, un sujet méconnu… Son voyage porte la notion de nouveauté et fait l'objet de préparatifs extrêmement précis. OA : Effectivement, contrairement au voyageur ou à l'aventurier, l'explorateur se doit, par son statut, d'apporter quelque chose à la société : l'écrivain-voyageur, un livre ; le réalisateur, un film ; le chercheur, des données. Ce qui est important, dans le cadre de la Bourse SEF-IRIS, c'est d'avoir initié soi-même l'exploration. Le candidat peut s'associer à d'autres personnes, mais il doit être le créateur de cette aventure plutôt que d'embarquer pour une grande expédition dont il n'est pas à l'origine. Son exploration n'a pas forcément à être grandiose, ni à l'autre bout de la planète, mais il doit en être l'initiateur, la préparer et la mener à bien de A à Z. FB : D'ailleurs, et nous le précisons dans les critères de sélection, la bourse s'adresse à des explorateurs qui vivent une aventure humaine. Il ne s'agit pas de mener une exploration purement scientifique, avec une bardée de machines, mais d'explorer et de découvrir le monde à travers le vécu d'une personnalité. Les notions de transmission sensible et d'émerveillement sont importantes pour la Fondation Iris dont l'objet est « d'aider à sauvegarder la fragile beauté du monde ». Il faut qu'il y ait dans le projet d'exploration à la fois de la science et du sensible. Pour cela, l'Homme doit être au cœur de l'histoire. OA : Avoir un sujet d'exploration en lien avec la biodiversité, évidemment. Mais la biodiversité doit être au centre du projet, non à la marge. Il faut aussi bien sûr qu'il y ait le respect de l'environnement aux sens physique – la sobriété dans les transports notamment – et humain. On passe forcément à côté de la cible si on ne travaille pas avec les gens sur place. C'est la complémentarité des connaissances et des approches culturelles et individuelles qui fait la qualité du résultat de l'exploration. FB : La biodiversité et les milieux naturels sont des biens communs de l'humanité. Confronter nos regards et nos savoirs avec ceux des populations locales est essentiel pour contribuer à leur préservation. Le partage fait partie des valeurs importantes de cette bourse, pas seulement avec la communauté scientifique, mais aussi avec le grand public. Il faut qu'il y ait une restitution. Tout est dans l'art de reformuler, retracer, rendre compte de cette exploration. Certaines personnes savent le faire avec talent, ce qui permet de toucher, de faire rêver et parfois de pousser à agir. OA : L'idée est de donner l'opportunité rare et puissante de réaliser un projet avec un haut niveau d'exigence sur des problématiques aussi fondamentales que la biodiversité, en toute indépendance. C'est le coût et le prix de l'autonomie, bien mise à mal depuis plusieurs années tant dans la recherche que dans les médias. Les laboratoires de recherche comme les sociétés de production par exemple ont de plus en plus de mal à trouver des financements pour des sujets pourtant essentiels mais jugés trop pointus, pas « à la mode » ou non prioritaires. FB : Les financements pour des expéditions non institutionnelles sont souvent morcelés, ils demandent beaucoup de temps et d'énergie aux porteurs de projet. La Fondation Iris avait envie de pouvoir contribuer à financer de manière déterminante un projet d'exploration scientifique autour du thème de la biodiversité. Sachant qu'en France, il existe un vivier de personnalités ayant la trempe pour mener des projets ambitieux et de qualité, utiles au bien commun.
FB : Il y a encore énormément de choses à découvrir. Il existe des zones blanches comme les abysses ou des cavités souterraines, mais il y a aussi des zones à re-découvrir. Soit parce qu'elles ont connu une évolution importante, soit parce que des technologies ou des personnes permettent d'apporter un nouveau point de vue. Les explorations d'hier peuvent être revisitées aujourd'hui. OA : Les explorations portent en elles une part de rêve. C'est l'aventure d'un homme, d'une femme, d'une équipe qui se lancent dans un projet difficile et qui montrent qu'il est possible de le réaliser. C'est important pour donner de l'espoir aux autres et susciter de la curiosité, notamment chez les plus jeunes. Aujourd'hui cependant, on se retrouve devant un défi énorme car les jeunes générations sont davantage habituées et soumises aux formats très courts et à l'immédiateté de l'information qu'aux livres ou aux longs documentaires scientifiques parfois assez pointus. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Mais il faut trouver de nouvelles façons de toucher les plus jeunes. Ne nous trompons pas, il s'agit là d'un véritable défi culturel et presque, osons le mot, civilisationnel. Car, sans véritable apprentissage, transmission des sciences, ni formations intellectuelles critiques, l'être humain ne peut rester libre. OA : Même si les deux sont intimement liés, plus que le dérèglement climatique, le vrai risque pour l'Homme est la disparition de la biodiversité. Car, s'il est possible de s'adapter aux variations du climat, l'Homme ne survivra pas à la disparition massive des autres espèces, végétales ou animales. Et en la matière, il n'y a pas de retour en arrière possible. La SEF a donc un rôle essentiel à jouer pour faire connaître cette biodiversité et les menaces qui pèsent sur elles. Aujourd'hui, les expéditions scientifiques qui touchent de près ou de loin à la biodiversité prouvent que, sur terre comme en mer, de nouvelles espèces peuvent être découvertes. Il ne faudrait pas, qu'en plus des extinctions majeures prouvées, nombre d'espèces inconnues disparaissent avant même d'avoir été découvertes. Si les explorateurs ne continuent pas ce travail, qui va le faire ? Cette mission est fondamentale. FB : Je pense que les atteintes que l'on fait au vivant sont pour beaucoup le résultat de notre insatiable besoin de produire et consommer, mais aussi pour certaines le résultat de notre ignorance. Il y a dix ans par exemple, on était prêt à aller exploiter les plaines abyssales parce qu'on pensait qu'elles n'abritaient aucune forme de vie. Aujourd'hui, grâce à l'exploration scientifique, on sait que c'est faux et que l'exploitation de ces zones pourrait avoir un impact important sur la vie dans les océans et donc, sur l'ensemble de la planète. Par ailleurs, les explorations permettent de braquer la lumière sur certains milieux dont on connaît la valeur environnementale et qui sont détruits à bas bruit. Je pense notamment aux forêts tropicales qui attisent les convoitises pour le bois, l'huile de palme, les minerais et le pétrole. L'expédition menée en Amazonie équatoriale par le lauréat 2023 de la Bourse SEF-IRIS, Damien Lecouvey, a permis de faire prendre conscience de la richesse de cet écosystème menacé par l'exploitation pétrolière, avec la découverte d'espèces nouvelles ou rares. Enfin, les explorations peuvent aboutir à la mise en place de moyens concrets pour la préservation d'un milieu. Le projet du lauréat 2022, Régis Belleville, a ainsi permis de développer une alternative aux 4x4 pour pister et étudier la biodiversité du Kalahari, au Botswana : des éco-patrouilles à dromadaires. L'expédition des lauréats 2024, Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon, prévue dans les tsingys de Namoroka à Madagascar, au printemps 2025, promet également de belles retombées pour la préservation de la biodiversité. propos recueillis par Marie Dormoy
|
 |
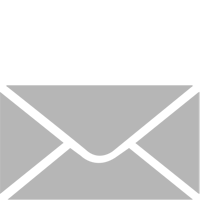 |


